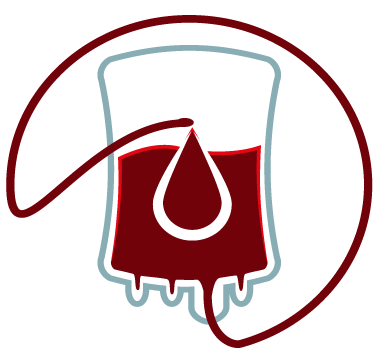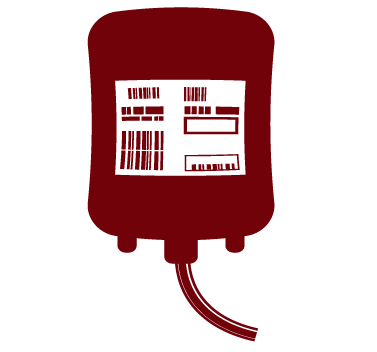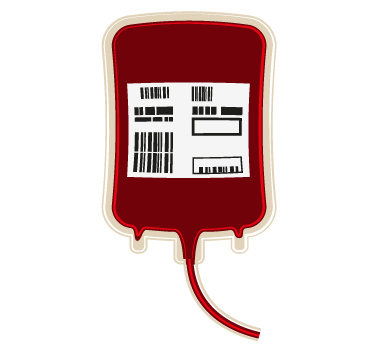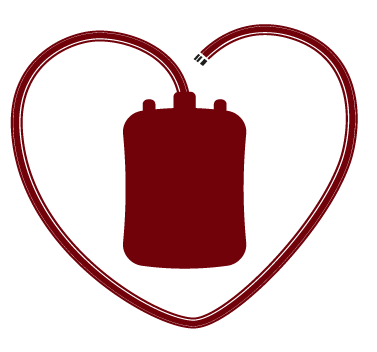Donner au suivant : pourquoi nous avons besoin que VOUS donniez du sang
Auteur : Jeannie Callum, MD, FRCPC
Publication en ligne de la version originale anglaise : août 2017
Jeannie Callum est hématologue et directrice du département de médecine transfusionnelle et des banques de tissus du Centre des sciences de la santé Sunnybrook. Elle est également professeure agrégée au département de médecine de laboratoire et de pathobiologie de l’Université de Toronto.
Témoin de l’impact du don de sang sur la vie des patients, elle raconte ici sa propre expérience et offre un angle fascinant sur la transfusion sanguine d’hier et d’aujourd’hui. « Il faut plus de donneurs masculins », insiste-t-elle, expliquant pourquoi certains donneurs sont plus sûrs que d’autres pour les patients.
.
Partie 1 : Un cadeau miraculeux — toujours là et prêt à servir 

Dans notre domaine, nous tenons le don de sang et la transfusion pour acquis. Non pas que nous le faisons volontairement, mais c’est chose si courante qu’on ne s’y arrête pas vraiment. En fait, pas moins de dix pour cent des patients hospitalisés reçoivent du sang. Jour après jour, les médecins commandent du sang pour leurs patients, et la banque de sang livre les unités demandées systématiquement et sans hésiter : le miracle d’une personne qui reçoit du sang parce qu’une autre en a fait don se perd un peu dans la routine. Mais de temps en temps, on voit un patient qui revient de loin grâce à la transfusion. C’est justement l’un de ces patients qui m’a amenée à écrire pour dire à quel point la transfusion sanguine est vitale et pourquoi VOUS devez donner, en particulier si vous êtes un homme.
Un de mes patients atteint d’un trouble sanguin s’est récemment présenté à l’urgence. Tous les deux ou trois ans, son système immunitaire déraille et détruit son propre sang. Habituellement, l’attaque cible ses plaquettes, de petits fragments de cellules qui contribuent à stopper les saignements. Cette fois-ci, l’attaque visait ses globules rouges. Les globules rouges sont des cellules en forme de beignet remplis d’une protéine appelée « hémoglobine »; c’est cette protéine qui transporte l’oxygène des poumons au reste du corps. Sans les globules rouges, vous pouvez inspirer et expirer, mais rien ne ramassera l’oxygène dans les poumons pour l’amener aux cellules du corps. En gros, vos cellules en viennent à manquer d’oxygène et à suffoquer.
Tout a commencé par de l’urine rouge. L’hémoglobine est rouge. Quand les globules rouges sont bombardés et détruits, l’hémoglobine est libérée dans la circulation sanguine. Lorsqu’elle n’est pas contenue dans la membrane d’une cellule, elle devient toxique, particulièrement pour les reins, qui l’évacuent dans l’urine. En quelques jours, le taux d’hémoglobine de mon patient est passé de 147 g/l, un taux normal, à 79 g/l. Puis le bombardement s’est accéléré et en quelques heures, l’hémoglobine est descendue à 29 g/l : mon patient avait perdu 80 pour cent de son sang, détruit par son propre système immunitaire. « J’avais l’impression que mon corps essayait de se suicider », m’a-t-il raconté.
Au moment où nous recevions les résultats montrant que son taux d’hémoglobine était très faible, il perdait connaissance. Nous avons tout de suite pris de la banque de sang quatre unités de globules rouges, que nous lui avons transfusées dans les heures suivantes. Sa vie ne tenait qu’à un fil, mais dans le temps de le dire, il était bien assis dans son lit et parlait de choses et d’autres. Un soulagement immense, et pour sa famille, et pour l’équipe soignante des soins intensifs. J’ai immédiatement pensé aux quatre donneurs qui avaient donné le sang que nous avions utilisé. J’avais envie de les appeler et de leur dire qu’ils venaient de sauver une vie.
Évidemment, je ne peux pas faire ça. Nous ne mettons pas les donneurs en contact avec les patients; la confidentialité est une barrière que personne ne franchit. Le personnel du centre de collecte connaît le donneur, et nous, à l’hôpital, nous connaissons le receveur, mais les deux ne doivent jamais se rencontrer. Mon patient a eu besoin de vingt unités de sang avant que nous puissions maîtriser son système immunitaire et lui permettre de rentrer chez lui.
Le miracle de la transfusion est quelque chose que je vois régulièrement, en particulier dans notre salle de traumatologie. Les victimes d’accidents de la route nous arrivent sans signes vitaux, mais les infirmières, équipées de quatre unités de sang prêtes à être transfusées, les ramènent à la vie. Toutes les six à huit semaines, il arrive qu'une femme en parfaite santé accouche, mais qu'après la naissance, au moment où le placenta se détache, l’utérus refuse de se contracter. La nouvelle maman commence alors à saigner abondamment. Lorsqu’une femme arrive à terme, le flux sanguin qui nourrit le bébé dans l’utérus est tellement fort qu’un saignement du lit placentaire peut la vider de son sang en sept minutes. Heureusement, nous avons toujours assez de sang pour donner aux obstétriciens le temps de freiner l’hémorragie.
Mais il n’y a pas que ces cas dramatiques qui me renversent, il y a aussi les patients qui reçoivent périodiquement des transfusions. Nous avons, à mon hôpital, un programme de transfusion pour les patients externes atteints d’une insuffisance de la moelle osseuse découlant soit d’une leucémie, soit d’une moelle osseuse malade. Ces patients ont parfois besoin de transfusions sanguines toutes les semaines pendant deux à quatre mois en attendant que la chimiothérapie ou une greffe de moelle osseuse les amène à une rémission. Certains patients doivent recevoir de 50 à 100 unités de sang par année pour rester en vie; c’est 50 à 100 donneurs pour soigner une seule personne. Nous avons même des patients qui viennent toutes les semaines depuis plus de cinq ans.
Je pense également aux bébés prématurés qui ont besoin de transfusions régulièrement pendant les premiers mois de leur vie. Une unité de sang est viable pendant 42 jours et nous pouvons, pour un bébé, prendre quelques cuillerées à soupe tous les deux ou trois jours et les expédier au service des soins intensifs néonataux. Nous avons un réfrigérateur réservé exclusivement à ces unités.
Dans ma tête, il n’y a aucun doute : sans la magie de la transfusion sanguine, tous ces patients mourraient.
Partie 2 : Une banque pas ordinaire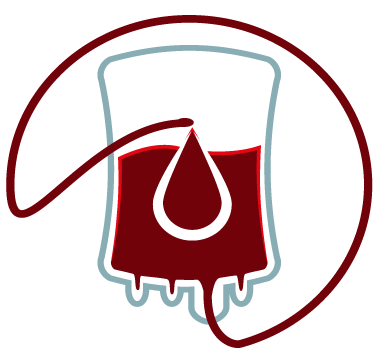
Le Dr Bernard Fantus (1874-1940) a mis sur pied la première banque de sang américaine à l’hôpital Cook County de Chicago en 1937. Il n’a pas appelé cela une « banque de sang »; il lui a donné un nom beaucoup plus professionnel : « le laboratoire de conservation du sang ». Apparemment, sa femme lui aurait dit que ce nom était trop compliqué et lui aurait suggéré à la place « banque de sang ». Le nom est resté, pas seulement à l’hôpital Cook County, mais partout dans le monde.
Les banques de sang des grands hôpitaux disposent d’une équipe rotative comptant de 20 à 50 technologues de laboratoire médical qui couvrent les activités de l’hôpital 24 heures par jour, sept jours sur sept. La plupart de ces technologues possèdent un baccalauréat en sciences, plus trois ans d’études techniques en médecine de laboratoire. Pendant ces trois ans, ils font la rotation entre les divers laboratoires des hôpitaux : microbiologie (où ils découvrent quels microbes vous rendent malade); chimie (où ils pratiquent des centaines de tests sur votre sang et votre urine); hématologie (où ils comptent les cellules dans votre sang); coagulation (où ils découvrent pourquoi votre sang ne coagule pas comme il le devrait); pathologie (où ils découvrent quel type de cancer vous avez) et, finalement, la banque de sang. Les technologues qui choisissent de travailler dans une banque de sang font partie d’un groupe à part. Ils semblent carburer à un stress intense. S’ils travaillaient à Wall Street, ce serait des « traders ».
Quand j’entre dans la banque de sang avant qu’un blessé arrive ou parce qu’un patient est victime d’une hémorragie dans la salle d’opération, tout est super bien rangé. Les réserves sont à leur maximum. À la banque de sang de mon hôpital, nous conservons 80 unités du groupe O comme réserve optimale, et quand le niveau descend en bas de 70, les technologues deviennent nerveux. Pour garder les stocks au bon niveau, ils remplacent les unités à mesure qu’elles sont utilisées et envoient donc des commandes à la Société canadienne du sang plusieurs fois par jour. Ils aiment que tout soit prêt et bien en ordre parce qu’on ne sait jamais quand il va y avoir une urgence. Avant qu’un patient traumatisé nous soit amené, nous recevons un appel nous informant de son arrivée. Un technologue envoie alors à la salle de traumatologie une glacière contenant quatre unités de sang du groupe O, sang du donneur universel.
Ceux d’entre nous qui sont du groupe O sont plus sollicités pour le don de sang parce que c’est ce sang qu’on utilise en cas d’urgence. Lorsque le trauma survient, si le patient est très instable, le chirurgien lance le code pour les hémorragies : « code oméga ». Il serait plus logique d’utiliser « code rouge », mais les pompiers l’ont déjà pris. « Code oméga » a été inventé par nos collègues de l’obstétrique pour éviter d’annoncer à tout le monde à l’hôpital qu’il y a une femme en train d’accoucher qui saigne massivement. Nous ne voulons pas que les nouvelles grands-mamans perdent connaissance en entendant un médecin lancer « hémorragie massive à la maternité »! Le code permet une réanimation rapide, coordonnée et standardisée.
Un porteur dévoué fait l’aller-retour avec des glacières de sang et des échantillons pour le labo. Des réchauffe-liquide, qui réchauffent le sang rapidement, sont apportés au chevet du malade. Nous utilisons aussi des chauffe-corps pour garder la température du corps du patient à 37 °C. Le sang ne coagule pas dans le froid. Chaque fois que le patient perd un degré, il perd 20 pour cent de son sang. Pour les technologues, ce patient devient une priorité. Le technologue en imagerie médicale (qui détermine l’étendue des dommages), les infirmières et les médecins de l’angio (où des radiologues spécialisés injectent une colle spéciale dans les vaisseaux sanguins fissurés), et la salle d’opération se préparent pour l’arrivée du patient.
Lorsqu’on entreprend la réanimation d’une victime d’un trauma ou d’un « code oméga », l’équipe de technologues travaille dans un silence quasi total. Un technologue commence aussitôt à tester l’échantillon de sang du patient. Il nous faut les résultats rapidement parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’épuiser nos réserves de sang du groupe O. Le test nous dit si le groupe sanguin du patient est A, B ou AB. Sans cela, nous risquerions de manquer de sang O. Un autre technologue prépare la glacière de trauma pour qu’il y ait toujours quatre unités de prêtes. L’équipe clinique sait qu’elle n’a pas besoin d’appeler d’avance; tout le monde sait que la prochaine glacière est là à attendre.
Un autre technologue se charge d’obtenir du plasma AB (groupe du donneur universel pour la partie liquide du sang qui contient les facteurs de coagulation) et de le placer dans le système de décongélation — un bain d’eau chaude qui agite le plasma pour accélérer la décongélation. L’équipe prend également dix unités d’un produit appelé « cryoprécipité » — qui est enrichi du facteur de coagulation 1, le fibrinogène, un facteur primordial pour arrêter les saignements — et les met à décongeler. Pendant que les produits décongèlent, ils étiquettent des unités de plaquettes.
Dans les quatre heures suivant l’arrivée d’un trauma grave, la banque de sang peut s’attendre à délivrer de 20 à 200 unités de sang. Chacun de ces produits vient de différents donneurs. Et la banque de sang reprend cette routine plusieurs fois par semaine.
Partie 3 : Les groupes sanguins ont la cote
Beaucoup de gens sont obsédés par leur groupe sanguin et le rôle qu’il joue dans leur santé. Certains vont même jusqu’à choisir certains aliments en fonction de leur groupe. Pour prévenir les complications associées à la transfusion, on doit tenir compte de deux systèmes sanguins. Le premier est le système ABO. Les ABO sont des antigènes d’hydrate de carbone (sucres) qui décorent nos globules rouges. Ils ont été découverts il y a une centaine d’années par le Dr Karl Landsteiner (1868-1943). Environ 45 pour cent d’entre nous sont du groupe A, et 45 pour cent, du groupe O; les 10 pour cent restants sont des groupes B et AB. Si, par erreur, on donne du sang A à un patient du groupe O, on risque fort de le tuer.
Au départ, tous les humains étaient du groupe A+. Pour être bien honnête, si vous étiez de n’importe quel autre groupe, vous étiez un mutant ou, comme j’aime croire en ce qui me concerne (je suis O-), plus évolué. Des centaines de milliers d’années à lutter contre notre ennemi, le parasite du paludisme (aussi appelé « malaria »), ont chassé cet antigène de nos globules rouges. Dans la « ceinture du paludisme » de l’Afrique subsaharienne, 80 pour cent des gens sont de groupe O. Il y a des maladies plus courantes chez les individus du groupe O et d’autres qu’on observe plus souvent chez les gens du groupe A. Par exemple, les gens du groupe O sont moins frappés par le cancer de l’estomac et du pancréas, mais font plus souvent des hémorragies. Ces différences demeurent un mystère.
Il y a eu une rivalité historique entre deux célèbres chercheurs anglais : George Garratty (1935-2014) et Peter Issitt. Le premier était du groupe O, et le second, du groupe A. Ils s’envoyaient l’un l’autre des documents démontrant la supériorité de leur groupe sanguin respectif. Garratty avait envoyé à Issitt un article disant que les individus du groupe O avaient un QI plus élevé, puis avait reçu d’Issitt un article décrivant la résistance des gens du groupe A à la peste. Était jointe à l’article une note : « Votre QI élevé ne vous sera pas d’un grand secours quand la peste reviendra. »
L’importance du rhésus
Les signes « + » et « – » qui accompagnent le groupe sanguin indiquent la présence ou l’absence de la protéine Rhésus D à la surface des globules rouges. Le Rhésus est le deuxième système sanguin dont nous devons tenir compte en médecine transfusionnelle. Cette protéine décorative sur les globules rouges est hautement immunogène. Environ quinze pour cent des personnes de type caucasien, sept pour cent des gens de descendance africaine et moins de un pour cent des Asiatiques ont un Rh négatif, ce qui signifie qu’ils n’ont pas cet antigène protéique. Chez les individus au Rh négatif, le gène D entier est supprimé. Nous n’avons aucune idée de ce qui a mené à l’élimination de ce gène et des raisons pour lesquelles son absence est si courante. Tout ce que je puis dire, c’est que cela crée beaucoup de travail pour les technologues des banques de sang et que nous devons avoir huit tiroirs de groupes sanguins au lieu de quatre.
Anti-D
Comme je l’ai déjà mentionné, l’antigène D est très immunogène, ce qui veut dire que dès la première exposition à une protéine étrangère, l’organisme déclenche une immunisation permanente contre cette protéine. Cette situation cause des ravages surtout pendant une grossesse. Toutes les femmes enceintes qui ont un Rhésus D- reçoivent du sang contenant des anticorps anti-D. Les anticorps dans le sang transfusé cachent les antigènes qui se trouvent sur la membrane des globules rouges du fœtus, lesquels circulent dans le sang de la mère. Sans ce traitement (un genre d’immunothérapie), les femmes D- détruiraient le sang de leur bébé, ce qui limiterait le nombre de grossesses qu’elles peuvent mener à terme. De nos jours, ce problème ne se pose plus vraiment, ce qui est un succès scientifique remarquable. C’est d’ailleurs grâce à cette percée scientifique que j’ai pu épouser l’homme que j’aimais sans me soucier du fait que son groupe sanguin (A+) est totalement incompatible avec le mien.
Partie 4 : Au-delà de la compatibilité ABO et Rh — groupes sanguins rares et collaboration internationale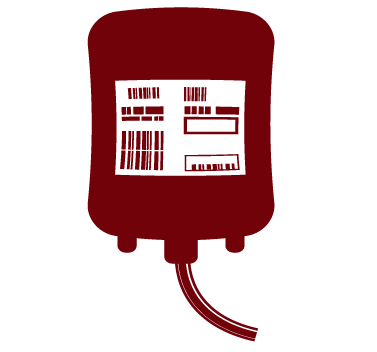
Mis à part ceux des systèmes ABO et Rh, il y a 346 antigènes de groupe sanguin contre lesquels un patient peut réagir — une source de stress de plus pour les technologues des banques de sang.
Il y a quelques années, nous avons reçu une charmante jeune femme dans la trentaine atteinte d’un cancer du sein. La maladie s’était propagée à sa moelle osseuse, ce qui limitait sa production de sang. Nous devions lui transfuser deux unités de sang pour qu’elle puisse poursuivre sa chimiothérapie. Tout s’est bien passé pendant les deux premières semaines, puis elle a commencé à se sentir mal. Son système immunitaire était en train d’attaquer l’un des 346 antigènes. Nous avons vérifié la compatibilité de son plasma avec celui des onze donneurs de notre panel standard (un outil pour déterminer la cible des anticorps). Elle n’était compatible avec aucun. Elle avait un anticorps contre une protéine non identifiée présente chez plus de 99,9 pour cent de l’ensemble des donneurs de sang. Nous devions trouver l’aiguille dans la botte de foin, l’unité de sang, parmi les milliers que nous avions, qui n’aurait pas cette protéine. Mais ce n’était pas tout. Son taux d’hémoglobine était sous les 60 g/l et elle avait besoin de sang sur-le-champ. Nous devions trouver rapidement la protéine exacte contre laquelle elle réagissait.
Lorsque les choses vont miraculeusement bien, les technologues disent que « les dieux des banques de sang nous éclairent ». Cette fois-là, nous avions aussi à l’hôpital une patiente admise pour un remplacement de la hanche. Cette patiente n’avait aucun des antigènes du système sanguin Kell. À notre connaissance, elle était la seule au Canada dans cette situation. Comme nous avions des échantillons des deux patientes, nous les avons comparés pour voir s’ils étaient compatibles. Bingo! La patiente à la hanche défectueuse avait le même groupe sanguin extrêmement rare que notre patiente au cancer du sein. Au moins, là, nous savions de quel type de sang elle avait besoin.
Heureusement, la patiente pour la hanche avait donné du sang à l’avance en prévision de son opération, mais n’en avait pas eu besoin. Nous avions donc deux unités de sang frais et plusieurs unités congelées, au cas où. Elle était à l’unité de réadaptation et son rétablissement se passait bien. C’était délicat, mais je devais lui demander si nous pouvions utiliser son sang. Je lui ai expliqué le dilemme. Ce que je lui demandais, c’était de nous permettre d’utiliser, pour une autre personne, quelques-unes des unités de sang qu’elle avait prévues pour elle. Par bonheur, cette patiente était une ancienne donneuse de sang et elle s’est empressée d’accepter. Elle se sentait tellement honorée de pouvoir aider. C’était la première fois qu’elle savait à quoi son sang allait servir. Quelques semaines plus tard, nous lui avons remis une lettre de remerciement anonyme de la personne qui avait reçu son sang. Je lui ai parlé au téléphone le jour même. Elle m’a confié qu’elle en avait eu les larmes aux yeux.
Lorsque ces deux patientes sont nées, il manquait à la surface de leurs globules rouges tout un groupe de protéines, les antigènes Kell. Chaque groupe d’antigènes est nommé d’après le nom de famille du premier patient ou de la première patiente chez qui l’on a observé l’absence d’un des antigènes. « Kell » vient de « Kellacher », nom d’une femme enceinte qui a éprouvé des problèmes associés à la maladie hémolytique du nouveau-né dans les années 40. La plupart des antigènes portent le nom de personnes qui ont eu des ennuis pendant une grossesse ou après une transfusion : Kell, Kidd, Duffy, Cellano, McLeod, Lewis. Bien sûr, on ne nomme plus les choses de cette façon, confidentialité oblige.
Pour revenir à notre patiente atteinte d’un cancer, il nous fallait lui trouver d’autres donneurs — et plusieurs — pour qu’elle puisse poursuivre sa chimiothérapie. Il était clair que le sang entreposé d’une dame âgée se rétablissant d’un remplacement de la hanche ne suffirait pas. Il faut savoir qu'un donneur de sang peut donner sans risque tous les 56 jours (hommes) ou 84 jours (femmes).
Chaque organisme de gestion du sang dans le monde a une banque de donneurs de sang rare, des donneurs qui n’ont pas tous les antigènes habituels à la surface de leurs globules rouges. Nous ne trouvons pas ces donneurs au hasard des tests que nous faisons; nous découvrons qu’ils ont un groupe sanguin rare lorsqu’ils tombent malades et réagissent mal à une transfusion.
Le centre du sang de Toronto a consulté sa base de données de donneurs canadiens et n’a trouvé aucun autre donneur. Difficile à croire, mais aucun donneur compatible non plus dans le registre des donneurs rares des États-Unis. Nous commencions à nous inquiéter. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel enthousiaste du centre de Toronto. Ils avaient trouvé un donneur prêt à faire un don à Helsinki, en Finlande. Nous aurions l’unité voulue dans les 48 heures. Puis d’autres bonnes nouvelles sont arrivées, du Japon cette fois : deux donneurs d’Osaka étaient compatibles et avaient aussi accepté de faire un don. Nous avions donc quatre donneurs qui pouvaient donner tous les deux mois. C’était suffisant pour que notre patiente puisse recevoir ses traitements de chimio. L’utilisation de médicaments bénéfiques pour le sang, comme le fer et l’érythropoïétine (une hormone du sang), allait aussi aider à réduire le nombre de dons de sang dont elle allait avoir besoin. L’unité d’Helsinki est arrivée et, comme prévu, elle était compatible; l’organisme de la jeune femme l’a tolérée. Une fois transfusée, la patiente s’est sentie un peu mieux.
Nous devions recevoir les deux unités d’Osaka quelques jours plus tard. Les donneurs devaient faire leur don le 11 mars et les unités devaient arriver à Toronto 48 heures plus tard. C’est ce jour-là, le 11 mars 2011, qu’est survenu le tremblement de terre de Tōhoku. J’ai appris l’horrible nouvelle dès mon réveil. Je me suis dit qu’il serait impossible pour la Croix-Rouge japonaise de nous aider. Ils auraient certainement à gérer d’importants besoins en sang et auraient sûrement des préoccupations beaucoup plus pressantes qu’une patiente canadienne. J’ai appelé la patiente; elle aussi, en était venu à la conclusion que le Japon, en pleine crise, n’enverrait pas le sang.
Nous avions tort. Les deux donneurs japonais sont allés faire leur don et la Croix-Rouge japonaise s’est arrangée pour que les unités de sang soient livrées à Toronto dans les 48 heures. Je me demande encore combien de gens ont dû faire pression pour que cette livraison se fasse malgré le puissant séisme qui perturbait le pays. Grâce à ces deux unités, notre patiente pouvait subir son traitement de chimio sans danger. Elle avait une chance de continuer.
J’ai envoyé au donneur d’Helsinki et aux deux d’Osaka des cartes de remerciement et des foulards au motif du drapeau canadien. Je ne m’étais jamais sentie aussi reconnaissante.
Environ une fois par année, notre hôpital a besoin d’un sang qui vient de loin pour un patient aux besoins particuliers. Il n’est jamais arrivé qu’un donneur refuse. Jamais. L’altruisme des donneurs de sang ne cesse de me surprendre.
Partie 5 : Le sang : pas toujours du pareil au même 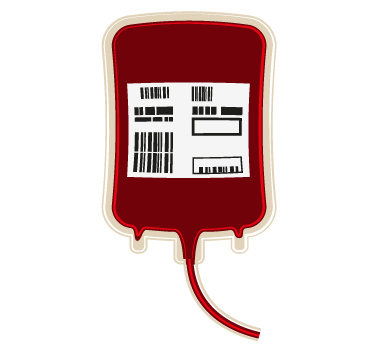
Les chercheurs commencent à peine à saisir le fait que certains individus font des donneurs de sang plus sûrs. En avril 2004, des spécialistes de la transfusion de plusieurs pays se sont réunis en congrès à Toronto pour prendre des décisions concernant le sang donné par des femmes, sang qui provoquait des réactions transfusionnelles graves (et parfois mortelles).
Pendant la grossesse, même une grossesse qui ne dure que quelques mois, le système immunitaire de la femme considère les tissus du fœtus comme étrangers et fabrique des anticorps pour les combattre. Ces antigènes sont transmis au bébé par le père, dont les tissus sont uniques et différents de ceux de la mère. Après trois grossesses, un tiers des femmes possèdent des anticorps détectables. Si le receveur de ce sang a la malchance d’avoir une génétique semblable à celle du père, il est probable qu’il réagisse mal à la transfusion. Ses poumons risquent de se remplir de fluides et de cellules immunitaires. Le patient en vient à avoir beaucoup de mal à respirer. Les trois quarts des patients touchés auront besoin d’être maintenus en vie artificiellement pendant quelques jours, jusqu’à ce que la réaction s’estompe. À l’époque du congrès de 2004, cette réaction, appelée syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel était la principale cause de complications majeures et de décès liés à la transfusion. Selon les meilleures estimations que nous avions à ce moment-là, ce syndrome touchait 1 patient sur 5 000.
En mars 2001, la revue scientifique Transfusion a publié un éditorial provocateur intitulé : « Transfusion-related acute lung injury: femme fatale? » (« Syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel : femme fatale? »). L’article remettait en question l’utilisation que nous faisons du sang de donneuses. Aujourd’hui, lorsque j’enseigne et que je parle de ce type de réaction transfusionnelle, j’insiste sur le fait qu’elle est causée par le sang transfusé et qu’elle doit être signalée à la banque de sang.
Pendant le congrès de 2004, les spécialistes de médecine transfusionnelle britanniques ont annoncé qu’ils avaient déjà apporté des changements pour réduire l’exposition des receveurs au plasma féminin (le plasma est la partie liquide du sang qui renferme les dangereux anticorps). Leur annonce a reçu un accueil critique (et un murmure de surprise de la part des centaines de spécialistes présents). Il y avait, à ce moment, peu de données scientifiques indiquant que les changements apportés allaient faire diminuer le taux de réaction. En médecine transfusionnelle, comme dans la plupart des domaines scientifiques, nous n’aimons pas faire des changements sans données probantes. La pression de la Grande-Bretagne forçait les autres fournisseurs de sang à emboîter le pas. À partir de ce jour, on a commencé à transfuser uniquement du plasma provenant d’hommes. Autre nouveauté : le plasma de donneuses n’était plus ajouté aux unités de plaquettes. Mais il n’était pas jeté pour autant. Les centres de sang l’envoyaient aux sociétés de produits sanguins pour qu’elles fabriquent des produits plasmatiques, comme l’immunoglobuline et l’albumine. On pouvait éliminer les dangers que posaient les dons des femmes grâce au processus de fabrication. Au bout du compte, les médecins britanniques avaient raison. Ça a marché. Le taux de ce type de réaction a baissé de moitié partout dans le monde.
Nouvelle recherche, nouvelles questions
Assisté de collègues, Dean Fergusson, scientifique pour le Programme d’épidémiologie clinique de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, a approfondi la recherche afin de mieux comprendre l’impact des caractéristiques des donneurs sur les résultats pour les patients. L’équipe de chercheurs a récemment étudié les résultats de plus de 300 000 transfusés qui avaient reçu du sang de plus de 80 000 donneurs. Ce qu’ils ont découvert est surprenant. L’étude a fait ressortir l’hypothèse que le sang de donneurs jeunes ou de femmes entraînerait un plus grand risque de décès pour les transfusés. Les raisons ne sont pas encore claires, mais il est urgent de poursuivre les recherches si nous voulons garantir aux patients les meilleurs résultats possible.
Les femmes représentent la moitié des donneurs de globules rouges. Pour que les transfusions soient sûres, on retire le plus de plasma possible de leurs dons de sang. Au Canada, il reste moins d’une cuillerée à soupe de plasma féminin dans une unité de globules rouges. Est-il possible que le danger provienne de cette petite quantité de plasma? Ou alors du tout petit nombre de cellules immunitaires dans l’unité? Ou bien peut-être y a-t-il quelque chose de différent dans les globules rouges mêmes? Bref, est-il possible que le sang des hommes soit plus sûr que celui des femmes?
Si les femmes ne pouvaient plus donner de sang, il faudrait que deux fois plus d’hommes en donnent. Les fournisseurs de sang mettraient des dizaines d’années à mobiliser autant de donneurs masculins. À l’heure actuelle, 36 000 unités de globules rouges sont transfusées chaque jour aux États-Unis. Chaque unité provient d’un donneur différent et la moitié de ces donneurs sont des femmes. Les États-Unis affichent l’un des taux de don les plus élevés au monde : dix pour cent des donneurs admissibles donnent au moins une pinte par an. Au Canada, le pourcentage est très faible : moins de quatre pour cent. Et à Toronto — ma ville —, c’est encore plus bas : moins de deux pour cent. Mais même les États-Unis, avec leurs taux de dons élevés, pourraient difficilement compter uniquement sur les hommes pour donner du sang, à moins d’un changement radical des mentalités. Ce serait encore plus difficile au Canada. Nous devons toutefois envisager l’idée que la transfusion pourrait être plus sûre si l’on comptait davantage sur les donneurs masculins. La seule façon de le savoir, c’est de l’essayer.
Obstacles à l’admissibilité
En lisant cet article, certains hommes se disent peut-être : « Je ne pourrais pas donner de sang même si je le voulais parce que l’organisme de collecte de sang m’a refusé. » Les donneurs sont refusés pour toutes sortes de raisons : un voyage dans une région à risque pour la malaria, un séjour au Royaume-Uni (risque de variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob), un tatouage, etc. Et pendant de nombreuses années, les hommes qui répondaient « oui » à la question « avez-vous eu des relations sexuelles avec un autre homme? » étaient exclus du don de sang indéfiniment, une décision prise par les organismes de réglementation du Canada et de la plupart des autres pays. (Dans la littérature scientifique, on utilise l’abréviation « HARSAH » pour désigner les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.) En 2013, l’organisme de réglementation du Canada a fait passer la période de non-admissibilité des HARSAH à cinq ans. Puis, en juin 2016, il a raccourci la période d’exclusion à un an après la dernière relation sexuelle. C’est un bon début, mais il faudrait des données scientifiques pour justifier les questions que les autorités de réglementation obligent les collecteurs de sang à poser aux donneurs.
La Société canadienne du sang et Héma-Québec, les deux organisations qui recueillent le sang au Canada, ont justement injecté 3 millions de dollars dans la recherche (avec l’appui de Santé Canada) pour que les scientifiques se penchent là-dessus. Nous devons être patients; avant que l’autorité de réglementation autorise un changement à la période d’exclusion actuelle d’un an, il faudra que les chercheurs fournissent des données solides. Nous devons aussi veiller à ce que les receveurs ne perdent pas confiance dans les réserves de sang. Il ne faut faire aucun faux pas; le Canada en a fait un dans le passé et il ne faut jamais que cela se reproduise.
Partie 6 : Mon propre parcours de don…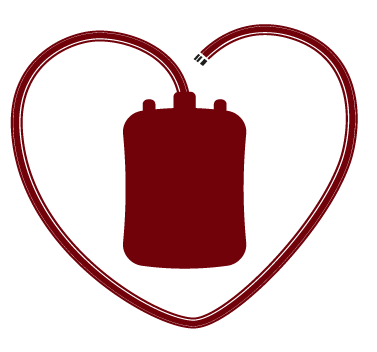
Donner du sang est une procédure vraiment mineure qui prend environ une heure. Je l’ai fait 28 fois, ce qui, en fait, n’est pas beaucoup. L’un des pharmaciens de mon hôpital a donné une centaine de fois. J’ai donné du sang total, des plaquettes, de la moelle osseuse et des cellules souches par aphérèse. Mais après qu’il a été démontré que les dons des femmes pouvaient provoquer un syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel chez les patients, j’ai dû cesser de donner des plaquettes. Je peux cependant continuer de donner des globules rouges.
En 2010, j’ai reçu un appel du programme UniVie de la Société canadienne du sang. J’étais compatible avec une personne qui avait besoin d’une greffe de cellules souches et on me demandait si je pouvais aller faire des tests pour confirmer que j’étais la meilleure option pour le patient. Je suis tout de suite allée donner un échantillon de sang, car quand on parle d’une greffe de cellules souches, le besoin est souvent urgent. Je n’ai pas eu de nouvelles pendant quelques semaines. J’avais 41 ans à ce moment-là, un an au-dessus de l’âge limite habituel. Normalement, les médecins préfèrent des cellules souches jeunes, qui ne sont pas endommagées par le processus de vieillissement. Le 23 décembre, il y avait un message sur ma boîte vocale me demandant de rappeler UniVie. Je tremblais. J’étais à la fois excitée d’avoir peut-être été choisie, et inquiète de me faire dire que je ne répondais plus aux critères (trop vieille, même problème qui frappe les femmes, comme je le mentionnais plus tôt). Mais la réponse était positive et on me demandait si j’acceptais de faire un don de moelle osseuse.
Bien sûr, j’ai dit oui. Mais j’ai immédiatement appelé l’un des médecins traitants pour m’assurer que la moelle osseuse était une nécessité médicale. (Le prélèvement est une opération bénigne d’une trentaine de minutes, mais le donneur doit quand même être sous anesthésie générale.) Il s’est avéré que c’était nécessaire; pour certaines maladies de la moelle osseuse, un don de moelle osseuse est ce qu’il y a de mieux pour le patient. En ce qui concerne le prélèvement, il n’y a pas grand-chose à dire. Ils ont pris l’équivalent de quatre unités de sang ou un litre de fluide de moelle osseuse. Le tout s’est passé à l’Hôpital Princess Margaret, le plus grand centre de cancérologie de Toronto. L’intervention était à 8 h, et à 10 h, je faisais la file avec ma tige à soluté pour commander un café. À 16 h, j’étais à la maison, et trois jours plus tard, j’étais de retour au travail. J’ai reçu un appel quelques semaines plus tard pour me dire que le prélèvement ne contenait pas assez de cellules souches et qu’il leur en fallait plus. Le patient pesait plus que moi. Ce devait être un homme.
J’ai pris des hormones sanguines pendant quelques semaines pour donner un coup de pouce à ma moelle osseuse, puis j’ai fait un don de cellules souches par un procédé appelé « aphérèse » (on vous branche à une machine qui filtre les globules blancs de votre sang). Peu de temps après, un de mes collègues en pathologie m’a contactée pour me dire qu’il regardait un échantillon de mon sang et qu’il craignait que j’aie la leucémie. Je me suis mise à rire, puis lui ai expliqué qu’on m’avait donné des hormones pour le prélèvement de cellules souches. Ma numération de globules blancs était passée de 4 à plus de 100. Pour lui, il y avait de quoi paniquer.
On m’a avisé lorsque mon receveur a subi sa greffe (j’ai pleuré, évidemment). J’ai reçu une lettre touchante d’un membre de la famille, peut-être sa femme ou sa mère, me remerciant de mon don. J’ai eu la lettre grâce à un arrangement entre le Canada et les États-Unis. Ça me fascine de penser que mes cellules souches sont quelque part de l’autre côté de la frontière. J’espère qu’elles se sont bien adaptées à leur nouvel environnement.
Chaque fois que je donne du sang, je me demande où il va aller. Les unités de globules rouges sont distribuées aux hôpitaux de sept à quatorze jours après la collecte, et normalement, elles sont transfusées à un patient dans les jours qui suivent. Les réserves doivent être suffisantes pour que les médecins puissent faire face aux urgences et aux fluctuations naturelles des besoins à la grandeur du pays.
Est-ce que mon sang est allé à une jeune fille atteinte de leucémie qui récupère après une chimiothérapie? Un petit garçon né avec une malformation cardiaque qui a dû être opéré quelques jours après sa naissance? Une personne victime d’un accident du travail? Quelqu’un qui a eu besoin d’une opération du cœur ou d’une greffe d’organe? Un patient qui a dû recevoir une greffe de cellules souches parce que sa moelle osseuse est malade? Un enfant devant recevoir une ou deux transfusions par mois en raison d’une drépanocytose? Ou un petit être arrivé des mois trop tôt qui a besoin de mon sang pour être nourri pendant ses premiers 42 jours de vie?
Merci!
Si vous avez donné du sang cette année, merci! Il n’y a pas de mot pour exprimer tout le bien que vous faites aux patients. Je pratique la médecine transfusionnelle depuis dix-sept ans et je m’émerveille encore de ce miracle. On vous demande de venir donner du sang et vous venez, sans demander ce qu’on en fera. Et chaque fois, vous sauvez une vie. Et vous revenez, année après année. Vous êtes des héros.
Il y en a parmi vous qui sont en parfaite santé et auraient pu donner du sang cette année, mais ne l’ont pas fait. Écoutez-moi : donner du sang, c’est très facile. Ça prend environ une heure. Si vous n’aimez pas les aiguilles, ne regardez pas quand on l’insère ni quand on l’enlève; ça ne fait pas vraiment mal quand elle entre et vous ne sentez rien quand elle sort. Si vous avez peur de vous évanouir, prenez vos précautions en buvant beaucoup de liquides la journée avant et les trois jours suivants. Ajouter du sel à votre alimentation le jour avant peut aussi aider; mangez un sac de chips salées pour vous récompenser. Si vous croyez que vous n’avez pas le temps, s’il vous plaît, pensez-y à deux fois. Tout le monde peut prendre au moins une heure ou deux par année pour sauver une vie.
Viendra peut-être un jour où ce sera vous qui aurez besoin de sang, ou quelqu’un que vous aimez. Environ la moitié d’entre nous devront recevoir une transfusion à un moment donné, et d’habitude, les gens ont besoin de plus qu’une seule unité. En règle générale, une fois que vous avez été malade, vous ne pouvez plus donner de sang. Alors, donnez maintenant, pendant que vous le pouvez.
Il faut donner au suivant; c’est la seule façon pour que ça fonctionne. Si vous êtes un jeune homme costaud dans la fleur de l’âge, que vous respectez les critères d’admissibilité (ex. : pas de tatouage dans les six derniers mois), mais que vous n’avez jamais donné de sang, regardez-vous dans le miroir et réfléchissez bien. Puis allez à sang.ca et prenez rendez-vous. Et s’il vous plaît, ne manquez pas votre rendez-vous; je compte — nous comptons — sur vous.
Jeannie Callum est hématologue et directrice du département de médecine transfusionnelle et des banques de tissus du Centre des sciences de la santé Sunnybrook. Elle est également professeure agrégée au département de médecine de laboratoire et de pathobiologie de l’Université de Toronto.